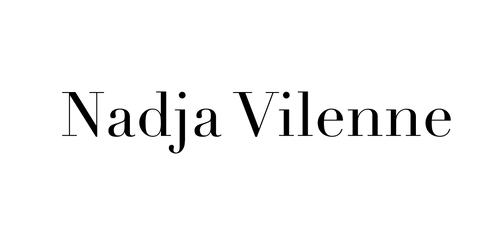BENJAMIN MONTI
C’est la nécessité de dessiner et de répéter – comme une leçon, une chanson, une posture – telle figure, qui est le moteur de l’imagerie poétique et acrobatique de Benjamin Monti. Cette nécessité de répétition, l’artiste en repère lui-même l’origine dans une première séquence troublante : trois portraits à peu près identiques de sa « mémé » réalisés vers l’âge de 7 ans et datés du jour même où elle mourut, se soustrayant ainsi de sa vue pour toujours. Est-ce pour affirmer que, depuis, il ne cesse de remplir un même devoir : être le sismographe de son existence, celui qui graphiquement en traduira les secousses ? Pourtant son œuvre n’est, en apparence, le symptôme d’aucun trauma profond. Son trait n’est pas expressionniste, qui relève d’une ligne claire, soigneusement posées sur du papier millimétré ou des pages d’anciens cahiers d’écoliers où figurent déjà des notes et des dessins tout aussi proprement appliqués. De même, ses figures ne sont pas personnelles, au sens où elles ne sont pas produites directement par son imagination mais extraites de l’imaginaire ready-made d’encyclopédies désuettes, de contes pour enfants ou de manuels d’apprentissage ; soit des images d’Epinal et des modèles stéréotypés qu’il s’applique calmement à recopier et surtout, à détourner avec malice. Mais que personne ne s’y trompe. Les dessins de Benjamin Monti, sages à première vue, procèdent d’un détournement du bon sens et de la bonne conduite, proche du surréalisme : on songe aux romans-collages de Max Ernst, comme La Femme 100 têtes (1929) ou Une semaine de bonté (1933). A bien les regarder, c’est d’ailleurs ce même parfum de délicate perversité qui s’en dégage ; fruit de l’union entre innocence et criminalité, jeu et cruauté, plaisir et souffrance. D’où, naturellement, l’impression que ses propres dessins, couplés souvent à d’autres sources, à des dessins d’autrui ou d’un autre âge, fonctionnnent comme ces « machines désirantes » que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont imaginées pour décrire l’inconscient non plus comme un théâtre mais comme « une usine, un lieu et un agent de production », et partant, le désir non plus comme manque mais comme « agencement ». C’est qu’il ne faudrait pas voir, par exemple dans les trois dessins d’enfant que Benjamin Monti a choisi d’intégrer à son oeuvre, que le signe d’une perte et de l’absence de « mémé » perpétuellement rejouée sur la scène familiale. Car ce serait ignorer la place, évidente aujourd’hui, de ces dessins dans une vision qui inscrit, sans interruption depuis l’enfance, ses signes singuliers dans un monde, un univers ou un cosmos qui préexistent à la famille. ‘L'inconscient ne délire pas sur papa-maman, il délire sur les races, les tribus, les continents, l'histoire et la géographie, toujours un champ social’. (Denis Gielen)
BIOGRAPHIE
Iconophage, collecteur d’images de tous genres, recycleur d’un corpus iconographique qu’il hybride, Benjamin Monti est né en 1983 à Liège. Il réalise son premier fanzine BD en 1997, rejoint le collectif BD « Mycose » en 2000 et participe depuis lors à de nombreux fanzines et graphzines. Dès 2009, son travail de plasticien est notamment présenté à la Fiac Paris, Art Brussels, ARCO Madrid, Art on Paper Bruxelles, Drawing Room Montpellier, Paréidolie Marseille, Le Lieu unique à Nantes, le Mac’s au Grand Hornu, le FRAC Picardie à Amiens, le musée des Beaux-Arts de Tournai. Depuis 2012, il illustre de nombreux textes d'auteurs : Cyrano de Bergerac, Bernard Noël, Rémy Leboissetier, Éric Therer, Boris Crack, Frédéric Schmitter, Jacques Perry-Salkow ou plus récemment, à La Pierre d’Alun, Armel Job et Thomas Vinau. Il réalise un travail graphique pour la collection « iF » (dirigée par Antoine Wauters) aux éditions l’Arbre à paroles. Il a exécuté plusieurs couvertures de livres pour la collection américaine des éditions Joca Seria. Benjamin Monti enseigne à l’Académie de Liège.