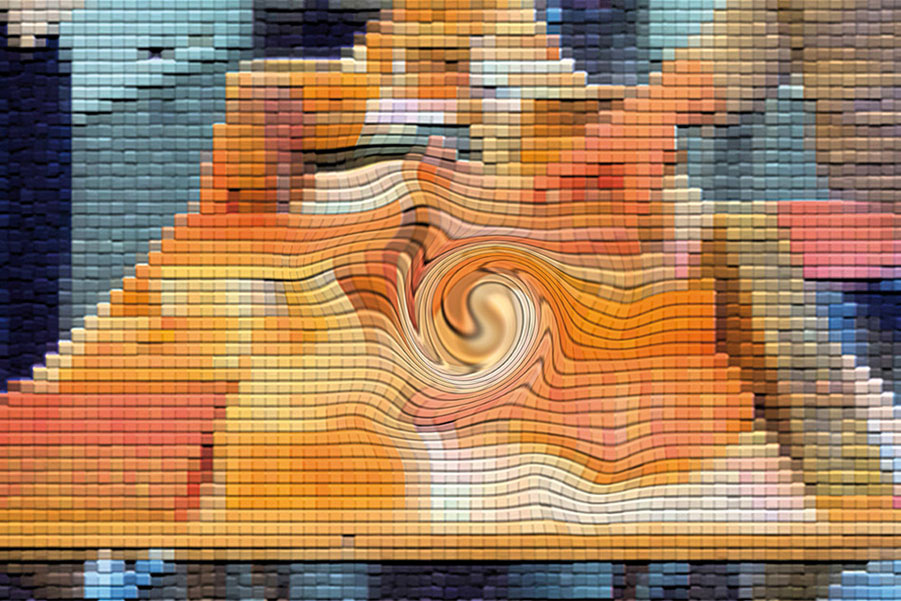Emilio Lopez Menchero est l’invité des Halles à Porrentruy. Il réinstalle, dan une nouvelle version, « H1-H2 », cette installation conçue après sa visite d’Hébron en Palestine et précédemment montrée à l’Iselp à Bruxelles. Gageons que le magnifique quadrilatère des Halles donnera, enfin, la pleine mesure à une œuvre qui suscite une réflexion essentielle sur une question cruciale d’actualité. Voici le texte paru sur ce blog lors de la conception de l’installation.
A Bruxelles, l’Iselp, tout proche de la Porte de Namur, est implanté dans un quartier bien connu pour ses nombreuses boutiques. On y flâne, on y lèche les vitrines, on y fait ses emplettes. « Dans les territoires palestiniens, à Hébron, on faisait aussi les magasins. C‘était avant 1967 et la guerre des Six Jours ». Dans le guide du Routard, édition 2011, cette remarque introduit la notice qui concerne la ville d’Hébron en Cisjordanie. Et le Routard précise : « Depuis, près de 600 colons juifs se sont installés au cœur de la ville musulmane, protégés par des soldats de Tsahal. Peu à peu, victime des violences, le souk de la vieille ville s’est éteint. Des centaines de magasins ont fermé, certains immeubles ont été évacués pour protéger ceux occupés par les colons. Des blocs de béton, des barbelés bloquent certaines rues aujourd’hui réservées aux seuls colons. Sur les toits des immeubles – colonies disséminés dans la ville, des soldats scrutent le territoire perchés sur des tourelles de garde ».
A Hébron, deuxième ville de Palestine, à 30 km au sud de Jérusalem, la situation est inextricable. Au cœur d’une vieille ville palestinienne sous haute surveillance, ces quelques micro colonies juives cristallisent les tensions. La cité est séparée en deux secteurs, H1 et H2. Le secteur H1, qui comprend à peu près les trois quart de la ville, est sous contrôle palestinien, ce qui n’empêche absolument pas l’armée israélienne d’y entrer quand bon lui semble. Le secteur H2 est sous contrôle israélien : il englobe la plupart des colonies, mais aussi la vieille ville, habitée par 20.000 Palestiniens. Hebron représente en effet pour les colons un enjeu majeur qu’ils justifient par des raisons historiques et religieuses. Les colonies se sont donc implantées au coeur de la ville, notamment près du tombeau des Patriarches avec la colonie de Avraham Avinou, l’une des plus extrémistes qui soit. On dénombre environ 600 colons, protégés par quelques 1500 soldats, soit presque trois soldats par colon. 170.000 palestiniens vivent à Hébron.
À Hébron, on visite en effet un lieu saint commun aux Juifs et aux Musulmans, le Tombeau des Patriarches, où repose Abraham. Autour a été bâtie une mosquée. Les Juifs et les Musulmans ont chacun leur accès, en étant surveillés, filtrés par l’armée. Dans la mosquée, des impacts de balles sont encore visibles, souvenir douloureux de l’acte fou du médecin Baruch Goldstein. En 1994, il mitrailla les musulmans en prière pendant le ramadan, tuant des dizaines d’entre eux. Certains colons extrémistes se rendent sur sa tombe en pèlerinage. La ville d’Hébron vit, depuis ce massacre, dans une tension permanente, une violence quotidienne entretenue par les soldats de Tsahal. D’anciens militaires israéliens ont d’ailleurs décidé de rompre le silence. « Breaking de Silence », leur association, a publié trois rapports adressés à l’ensemble de la société civile israélienne et la communauté internationale, trois rapports énumérant des dizaines de témoignages de militaires qui évoquent les humiliations, les arrestations arbitraires, le harcèlement, les injures, la violence et la terreur dont ils ont été les témoins et bien souvent les acteurs durant leur service militaire à Hébron. Leur objectif : combler le fossé qui existe entre leur vécu et le silence qui règne dans les familles israéliennes, témoigner afin d’exorciser les traumatismes qu’ils déclarent souvent avoir subi.
Emilio Lopez Menchero s’est rendu à diverses reprises en Palestine à l’occasion d’une série d’échanges entre La Cambre – Horta Architecture, où il enseigne, et l’Université Birzeit, toute proche de Ramallah. En 2009, l’année où il visite Hébron, il dirige et anime un workshop organisé par Al Mahatta Gallery, une initiative d’artistes basée à Ramallah, soucieuse de fonder une plateforme professionnelle et internationale en Palestine : « Inside/Outside », intitulé de ce workshop, aborde la question de l’intervention dans l’espace public et circonscrit les domaines de la performance, de l’action et de l’intervention plastique. Toute la réflexion tourne autour de la spécificité socio – politique de la Palestine.
A propos d’Hébron, Emilio Lopez-Menchero témoigne bien sûr de ce qu’on appelle pudiquement « le principe de séparation » qui a radicalement transformé la circulation dans le centre ville d’Hébron et mis à mal toutes les activités de la population palestinienne. Alors que nous parlons de son expérience, il évoque les check points en chicane, la partition du Tombeau des Patriarches, les rues désertes et les centaines de boutiques fermées par l’armée pour « raison de sécurité », les pressions et le harcèlement dont les populations du centre ville sont l’objet afin de les pousser à fuir et à abandonner leurs maisons, la fermeture de la rue Suhada, principale artère commerçante avant la seconde Intifada en plein cœur historique de la vielle ville palestinienne, une rue que ne parcourent plus que les militaires et les familles de colons qui se rendent au Tombeau d’Abraham. L’œuvre qu’il propose aujourd’hui s’appelle simplement « H2-H1 », ces lettres et chiffres qui scellent la partition de la ville. Il conclut en me disant : « Hebron s’appelle Al Khalil en arabe, ce qui veut dire l’Ami en référence au prophète Abraham. Son nom hébreu, Hevron, a la même signification. Je suis arrivé à Hébron un vendredi. C’est le jour le plus singulier de la semaine, jour de la prière musulmane, alors qu’au soir débute le Sabbath. J’ai donc pu observer l’absurdité de la situation autour du Tombeau des Patriarches. Un même check point filtre les deux religions monothéistes, il révèle ce système de scène et de coulisses où synagogue et mosquée ne sont séparées que par un mur mitoyen ».
En déambulant dans le centre ville, son attention a été attirée par de singuliers filets tendus au dessus des ruelles. Ces filets et ces grilles sont jonchés de détritus, de déchets de tout genre, des débris de mobilier, des ordures ménagères ou même des bouteilles remplies d’urine ! Ce sont les habitants qui ont tendu ces filets pour se protéger des détritus que les colons jettent par leurs fenêtres. Certaines maisons palestiniennes sont en effet collées aux maisons des colons et ces dernières surplombent. Qui s’aventure dans ces rues déambulera entre des façades aux volets clos, sous des tonnelles de crasses. Ce sont là des actes qui démontrent le mépris dans lequel les colons tiennent la population.
L’installation que propose Emilio Lopez Menchero à l’Iselp est dès lors radicale. Par dessus la salle de l’Atelier, il a tendu des filets et y a jeté toute sorte de choses, toute sorte de déchets. En accédant à la coursive qui surplombe l’Atelier, le visiteur aura le point de vue des colons ; sous les filets, celui des habitants palestiniens d’Hébron. Singulièrement énigmatique, car rien, pas même le titre de l’installation, ne fait explicitement référence au fait précis évoqué, le dispositif témoigne silencieusement et avec force de cette intolérable situation. Réduit à une expression minimale, un filet, des déchets, il condense une situation complexe qui dépasse, de loin, son objet. Sans discours superflu, il invite à s’informer, à réfléchir ce conflit entre deux peuples : Hébron est le symbole même du conflit israélo-palestinien, son centre cristallise l’épineuse question des colonies israéliennes qu’elles soient en Cisjordanie, dans la bande de Gaza ou sur le plateau du Golan. Hébron concentre toute les problématiques de l’extrémisme religieux et de l’apartheid. Emilio Lopez-Menchero aurait pu se contenter, comme d’autres l’ont fait avant lui, de documenter ces « aménagements » pour le moins sauvages de l’espace social et urbain. Ici, il n’est ni question de documenter ou de reconstituer, il est question d’utiliser le langage plastique et, je dirais même, un artifice de situation, un filet, des déchets installés dans une institution artistique. Le dispositif est presque incongru. Je repense à ce texte de Jacques Rancière sur les paradoxes de l’art politique : « Le problème, écrit-il, ne concerne pas la validité morale ou politique du message transmis par le dispositif représentatif. Il concerne ce dispositif lui-même. Sa fissure laisse apparaître que l’efficacité de l’art ne consiste pas à transmettre des messages, donner des modèles ou des contre-modèles de comportement, ou apprendre à déchiffrer les représentations. Elle consiste d’abord en disposition des corps, en découpage d’espaces et de temps singuliers qui définissent des manière d’être ensemble ou séparés, en face de ou au milieu de, dedans ou dehors, proches ou distants ». C’est bien le cas, ici.
L’EAC ( les halles) présente une installation réalisée par Emilio López-Menchero qui s’inscrit dans la continuité du projet de dialogue entre artistes du Jura et de la communauté francophone de Belgique.
Emilio López-Menchero 1960, d’origine espagnole. vit et travaille à Bruxelles.. Architecte de formation, il met en scène son histoire personnelle et sa réflexion sur la société à travers les différents médias que se soit sculpture, dessin, installation, performance, photographie ou peinture. L’artiste doit sa notoriété notamment aux œuvres qu’ils réalisent dans le cadre de son concept-performance « Trying to be », série de photos, de performances vidéo et d’autoportraits incarnant des personnages légendaires.
L’installation intitulée H2 / H1 présentée à l’EAC les halles fait référence à la désignation des deux zones territoriales séparées de la ville d’Hébron en Cisjordanie où Colons Israéliens et habitants Palestiniens vivent les uns sur les autres dans une tension conflictuelle permanente extrêmement violente séparés par une frontière horizontale surveillé par l’armée israélienne, constituée d’un grillage suspendu continu recouvrant l’entièreté des ruelles du souk de la ville. Ce grillage aérien sert à retenir tous les déchets jetés volontairement par les colons sur les palestiniens.
Au-delà du stéréotype de cette Suisse propre-sur-elle, l’installation H2/H1 est une transplantation d’une réalité d’un lieu à un autre. En reprenant l’expression « lost in translation » cette recontextualisation à l’EAC ( les halles) modifie ou plutôt s’enrichit de nouvelles significations. Son référent Proche Oriental pourrait être rapporté à l’histoire conflictuelle Helvétique , particulièrement dans le Jura,avec ses questions culturelles et identitaires et la complexité que tous ces enjeux suscitent. Elle pointe du doigt La situation politique en Suisse notamment en matière d’écologie, les aberrations en matière de production d’énergie (surenchère d’éoliennes) mais aussi la question du triage des déchets etc.
Emilio López-Menchero réalisera une édition dans le cadre de l’exposition.