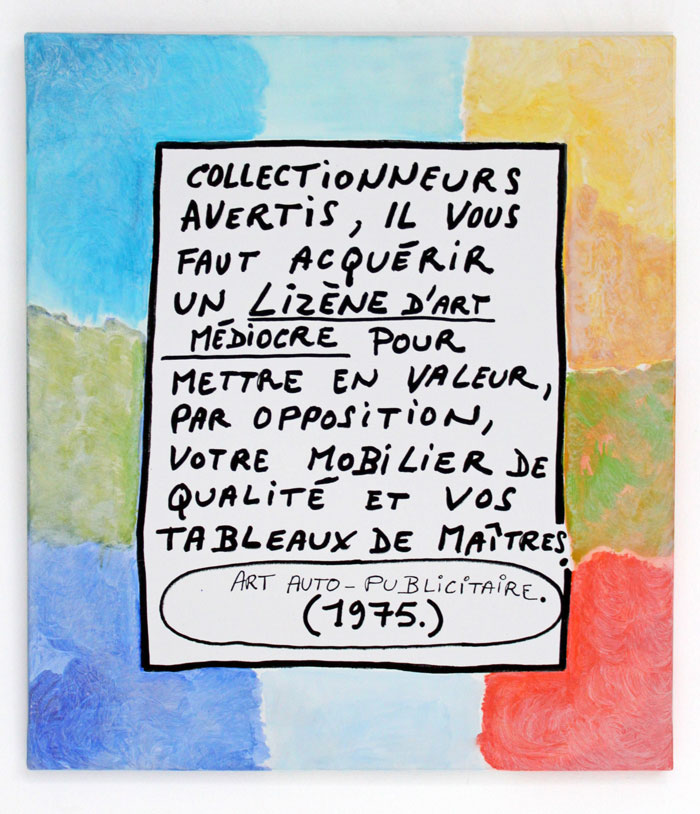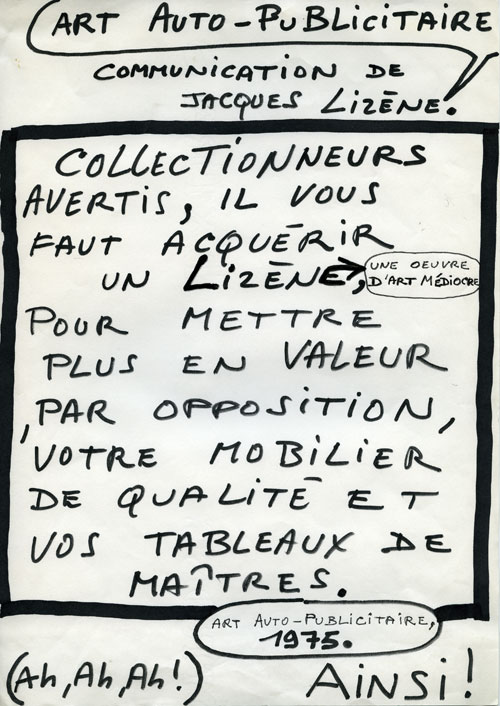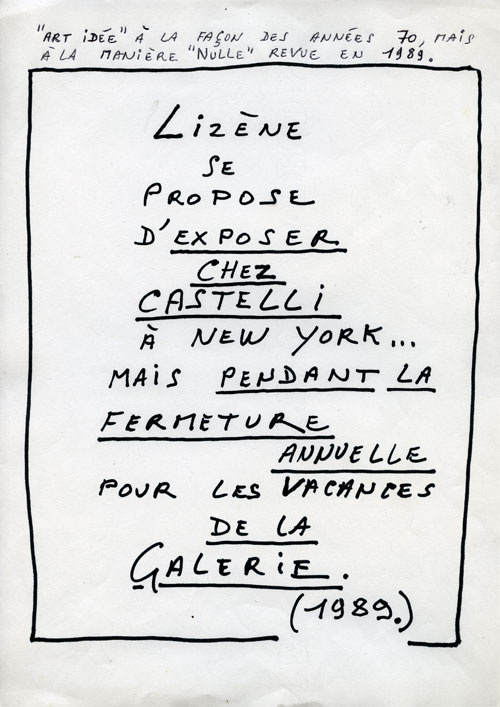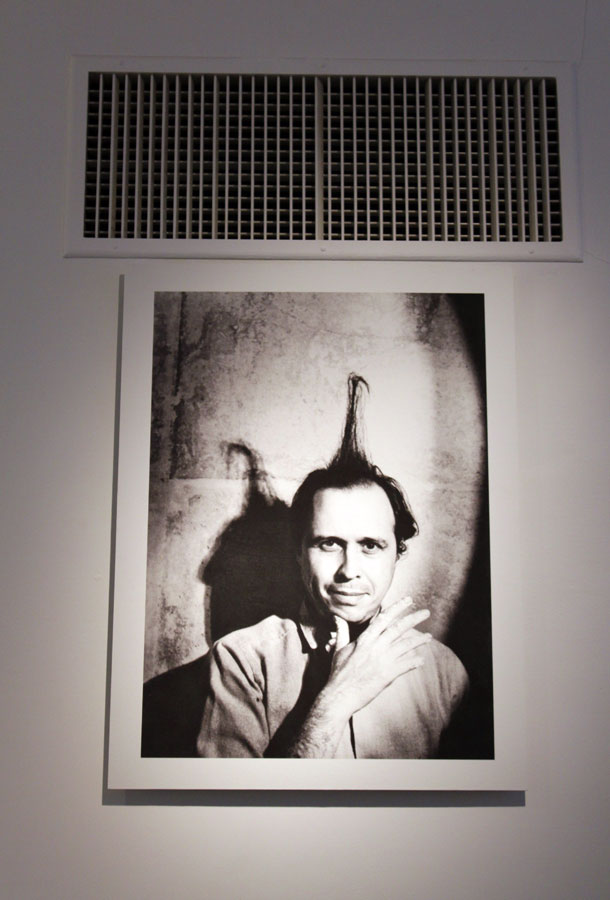Marie Zolamian participe à l’exposition NowBelgiumNow, organisée par Ulrike Lindmayr et Stella Lohaus au LLS287 à Anvers. L’exposition regroupe quelques artistes émergents tant du Nord que du Sud du pays, remarqués par les deux commissaires au fil de nombreuses visites d’ateliers.
L’objectif de ce projet d’exposition est d’initier un discours artistique indépendant de toute tendance communautaire tant au niveau culturel, qu’au niveau politique. Cette vaste prospection, un gigantesque tour d’ateliers dans différentes villes telles qu’Anvers, Gand, Bruxelles, Hasselt, Mons, Charleroi, Liège, … a abouti à une sélection de neuf artistes. Force est de constater que chacun des (jeunes) artistes invités expriment leur engagement social par des méthodes totalement différentes. Certains utilisent le mode de l’infiltration, d’autres se laissent inspirer par l’histoire du lieu, d’autres encore tentent de mettre main mise sur la réalité par le biais de leur propre univers. L’exposition NowBelgiumNow rassemble neuf artistes fascinants qui enrichiront sans conteste le circuit artistique existant.
Exposant dans les greniers du châtelet d’entrée de l’ancien hôpital militaire d’Anvers, Marie Zolamian poursuit un cycle de peintures de petits formats dont elle montrait une première série à la Chataigneraie à Flémalle voici quelques mois. Dans la publication qui suivit et accompagna cette exposition (« Des Lieux d’élection », aux éditions l’Usine à Stars) j’écrivais ceci :
(…)L’identité, l’accueil ou l’ostracisme, l’inscription dans une communauté, la mémoire, le déracinement, les flux migratoire, l’exil choisi sont au coeur des préoccupations de Marie Zolamian. C’est là toute l’expérience de l’itinéraire en dehors, du départ et du retour, de la temporalité vécue du voyage, de cette topographie, ce topique où se mêle l’extérieur et l’intime. Je songe à ce texte de Michel Guérin évoquant cette rencontre avec la mort, qui traverse, transcende même, le onzième Chant de l’Odyssée d’Homère. Il y pointe la pratique des passages et la reconnaissance des limites, les chemins du désir, le dépassement de l’intérêt égoïste au profit d’un au-delà de l’individualité. « L’homme se déplace, change de lieux, écrit-il, d’entours, de sentiments parce que sa finitude l’oblige, à défaut d’une présence pleine à soi, à traverser la vie et le temps compté (tantôt ralenti, tantôt précipité), à se chercher ailleurs, au-delà, plus haut, plus bas, à friser l’héroïsme et à côtoyer l’abjection, à se déporter de son être, à quêter la voie incertaine, sinon du salut et du bonheur, du moins d’un certain « retour dans la patrie ». Cela se nomme expérience. Elle a trois aspects : c’est une pratique, c’est un chemin, c’est enfin une mise en intrigue ». Le voyage est alors créateur.
D’identité et de souvenance, il est bien sûr question dans la série de peintures « nous partout », inspirée d’anciennes photographies noir et blanc et anonymes. Quatre enfants, une dame, peut-être leur mère, leur grand mère, campent dans treize paysages, dans treize environnements différents, sur le pont d’un bateau, devant une grosse berline, non loin d’une roulotte, tout près d’un château au bord de l’eau, ou d’un moulin, sur un quai sans doute le long de l’eau, un quai de gare aussi, sur la plage, dans le couloir d’une piscine publique, au restaurant enfin. En arrière plan de l’une d’elle, on reconnaît la citadelle de Huy ; la toile agit comme une carte postale. En chaque lieu, sans doute à peine arrivée ou déjà prête à repartir, cette petite tribu pose devant l’objectif suivant un même rituel, où chacun a sa place bien précise. « nous partout », explique Marie Zolamian, c’est cette identité hybride, la cristallisation d’une mixité culturelle, la reconstitution d’un réseau familial perdu, une reconstruction fondée sur la fragilité ».
« Le temps, signe d’impuissance, écrit encore Michel Guérin, est aussi gage et voie de restitution (autrement) de ce qui s’est échappé d’abord de notre être poreux. Le voyageur veut savoir et il soupçonne que la vérité n’est nulle part ailleurs que dans la dialectique des faits et des idées, de la familiarité et de la distance ». Ces toiles ont la simplicité et la sobriété d’intimes photographies de famille ; c’est celle-ci qui, ici, effectue le voyage créateur et s’ancre au fil de ces quelques transhumances que l’on devine estivales.
Tout aussi petites, libres, tendues sur le mur comme une peau, la toute récente série de toiles que Marie Zolamian confronte aux « nous partout » a été initiée après la découverte du film « Departures » de Yojiro Takita, une oeuvre qui entraîne le spectateur dans le monde peu connu des rites funéraires japonais, à travers l’itinéraire de Daigo, un ex-violoncelliste devenu croque-mort malgré lui. Sans métier désormais, il répond à une annonce d’emploi « d’aide aux partants », croyant qu’il s’agit d’une agence de voyage. Ces petites toiles sont autant d’intimes et sensibles contrepoints : Marie Zolamian peint des gisantes dans des intérieurs familiers, seules, parfois veillées par une femme, des chambres aux secrets bien gardés, des décors parfois réduits à l’essentiel, un tapis, un meuble, un portrait d’aïlleule, matriarcal. Toutes ces jeunes filles portent des vêtements de communiantes ou de mariées, des habits de fêtes, rites du franchissement ; elles semblent assoupies, mais le sont-elles, dans un monde flottant, images de tout passage et des rituels qui les accompagnent, de la présence à l’absence. L’antique « Nekuia » du onzième Chant de l’Odyssée est, on le sait, une invocation aux morts. Et « le sens du voyage créateur, conclut Michel Guérin, est ensemble de libérer la vie de l’emprise constante et furtive de la mort, de revenir vers les choses et les êtres avec ce regard élargi de l’artiste que le romancier japonais Kawabata a nommé le regard ultime».
Invitée par Vanessa Desclaux à exposer durant l’été au château de Châteauneuf, en Bourgogne, pour une exposition intitulée « A corps perdu », Marie Zolamian a poursuivi sa réflexion et enrichi cette série « sans titre » de gisantes. Vanessa Desclaux épingle cette citation de Blaise Pascal , adoptée par l’artiste : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos, dans une chambre » et écrit à ce propos :
(…)L’expérience d’un corps absent, l’horizon de sa dématérialisation ou de sa destruction, physique ou symbolique, est au coeur du choix et de l’articulation des oeuvres de l’exposition. L’histoire du lieu qui se déploie sur plusieurs siècles et la possibilité d’une mémoire, réelle ou imaginée, que le lieu met en mouvement, est le théâtre d’une mise en scène d’oeuvres contemporaines qui proposent des représentations du corps en tension, mis à mal dans ses multiples dimensions historique, sociale, politique ou littéraire.
Ce corps n’est pas seulement l’objet d’une tentative de représentation qui ne cesse d’échapper au domaine du visuel ; il est aussi le corps du visiteur mis à l’épreuve de l’exposition en tant que forme d’expérience physique et mentale. Les artistes invités dans le cadre de cette exposition énoncent de manière personnelle et subjective un rapport du corps à l’espace – à la fois plastique, social et politique. L’espace du château est l’objet d’insertions, d’interventions, et de juxtapositions entre ses espaces qui construisent une mémoire historique et des oeuvres qui tentent de faire émerger une autre qualité de présence, se posant à la fois en écho au contexte du lieu, et en confrontation avec lui, y superposant de nouveaux récits, et de nouvelles expériences sensibles. (…)
Marie Zolamian a réalisé une série de quatre peintures qui reprennent de manière très détaillée le décor de trois des chambres du château de Châteauneuf. Dans ces décors, eux-mêmes reconstitutions historiques des pièces intérieures du château, Marie Zolamian intègrent la présence de figures allongées sur les lits. Ces figures s’inscrivent dans la continuité d’une recherche entreprise par l’artiste depuis 2010, donnant naissance à une première série de petites peintures, qui ont la particularité d’être des fragments de toile en lin brut, préparés à la colle de peau qui leur confère un contour irrégulier. Cette forme donne à la peinture un statut d’objet qui rappelle le rapport intime et contemplatif à l’icône.
Les chambres de Zolamian se déclinent comme des lieux en retrait, à l’écart d’un temps ou d’un lieu spécifique. Les toiles délimitent des fragments d’espace où ces personnages sont enfermés dans le secret du sommeil, ou celui de la mort. Le regard glisse à huis clos d’une peinture à une autre, suivant une sorte de rituel, passant d’une histoire à une autre, d’un état – physique ou psychologique – à un autre, avec un sentiment d’égarement mêlé d’étrange familiarité. (..)
A Anvers, Marie Zolamian s’est à nouveau inspirée du contexte. On lira dans l’excellent guide du visiteur qui accompagne cette enthousiasmante exposition :
Attirée par l’histoire du site de l’hôpital militaire, Marie Zolamian a retrouvé trois religieuses, qui entre 1946 et 1993, y ont travaillé en tant qu’infirmières. L’œuvre « Before after » est composée d’une installation sonore qui nous fait entendre les voix des sœurs, tandis que leurs portraits, peint à l’acrylique sur toile, sont exposés dans une vitrine. Elles se racontent leurs souvenirs et comment les choses ont changé. Ce qui frappe sont les reconstructions vagues, l’importance qu’elles portent aux futilités, les quiproquos, les redites et le manque de précisions géographiques. Les trois sœurs se corrigent et surenchérissent. L’une d’elle a travaillé 38 ans sur le site, l’autre 48 ans. Les religieuses ont les mêmes émotions que tout autre humain et pourtant bous les associons avec la paix, la bonté, la patience. Tout l’étage de la tour est plongé dans une atmosphère sereine, le passé est derrière la porte. Les œuvres posées dans les vitrines représentent des femmes dont il est impossible de dire si leur sommeil est vrai, ou éternel. Leurs corps dégagent un apaisement solennel. Les tableaux montrent des femmes passives, souvent entre deux mondes : baptême, mariage, cérémonie religieuse, méditation, attente, réflexion. Presque toutes portent une robe blanche. La paix et l’abandon qui émanent des œuvres contrastent avec les chuchotements que l’on entend derrière la porte à demi fermée. La frontière entre la vocation et la soumission est infime, le monde idéal et le monde réel se rencontrent rarement.
L’œuvre de Zolamian aborde souvent le thème de la mémoire collective. Elle tente de rendre visible des moments ou des lieux perdus ou oubliés.